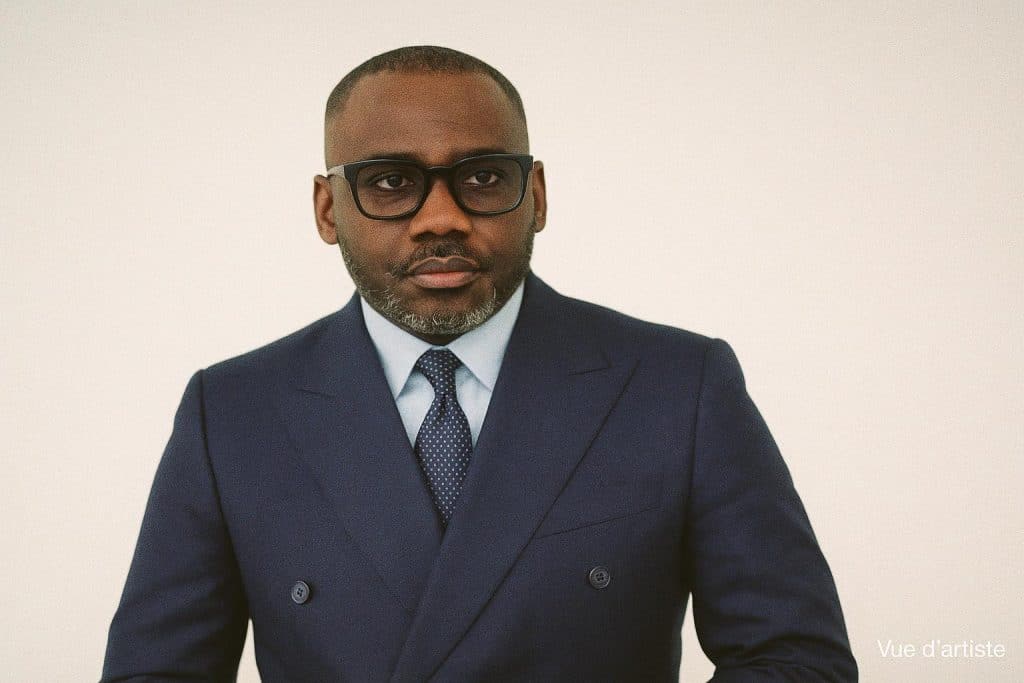La mémoire des grandes heures
Lorsque Brazzaville inaugura, en 1996, le Festival panafricain de musique, la jeune manifestation fit aussitôt figure de trait d’union entre les deux rives du fleuve Congo et, au-delà, entre les imaginaires musicaux du continent. Certains observateurs se souviennent encore de l’ovation qui salua, cette année-là, les ensembles de rumba venus de Kinshasa, Dakar ou Abidjan. Porté par l’État, le FESPAM naquit au croisement d’une ambition culturelle—faire résonner l’unité africaine—et d’une volonté géopolitique, celle d’inscrire la République du Congo dans le cercle restreint des capitales de la diplomatie culturelle africaine. Presque trois décennies plus tard, la mémoire de ces grandes heures constitue toujours un capital symbolique de premier plan.
Les contraintes d’un environnement régional mouvant
Le paysage festivalier africain s’est considérablement densifié. Au Maroc, le Mawazine attire plus de deux millions de spectateurs ; à Cotonou, le Festival Sô à la Lagune mise sur les industries créatives émergentes. Face à cette concurrence croissante, Brazzaville doit composer avec une équation budgétaire contrainte par les priorités sociales et sanitaires post-pandémie, tout en préservant la qualité artistique. Le ministère congolais de l’Économie rappelle qu’entre 2020 et 2022 les ressources affectées à la culture représentent moins de 1,5 % du budget de l’État, un ratio comparable à la moyenne africaine (source : Commission de l’Union africaine).
Des choix budgétaires sous haute vigilance
La décision présidentielle de maintenir le FESPAM, fût-ce sous un format resserré, relève d’un arbitrage délicat : concilier la soutenabilité des finances publiques et le maintien d’un levier de soft power. Selon un conseiller au Trésor public, « annuler l’événement aurait envoyé un signal de décrochage culturel, difficilement compréhensible alors même que la relance économique est amorcée ». Brazzaville a donc opté pour une édition concentrée sur les conférences, les ateliers professionnels et quelques concerts vitrines, laissant aux partenaires privés le soin de compléter l’effort financier.
Le pari d’une édition resserrée mais stratégique
L’édition 2023, qui s’est tenue du 15 au 19 juillet, n’a réuni qu’une trentaine d’orchestres, contre plus du double en 2017. Pourtant, l’UNESCO a salué la démarche « office-laboratoire » qui a permis la création d’un incubateur de start-ups musicales, première brique d’un chantier plus vaste sur la numérisation des patrimoines sonores. La cérémonie d’ouverture, présidée par Denis Sassou Nguesso, a insisté sur la « professionnalisation des chaînes de valeur culturelles » plutôt que sur la démesure scénique. En filigrane, l’État espère attirer l’investissement diasporique et renforcer l’employabilité des jeunes musiciens.
Synergies transfrontalières et avenir de la Rumba
L’autre axe stratégique porte sur la coopération transfrontalière. En février 2023, les gouvernements congolais et congolais-RD ont signé à Kinshasa un mémorandum créant un « Passe-culture » valable des deux côtés du fleuve afin de faciliter la mobilité des artistes. Cette mesure anticipe l’inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l’humanité et entend faire du FESPAM la plate-forme principale de ce genre musical pluriel. « La rumba ne connaît pas de frontière ; elle est notre passeport commun », rappelait le musicologue Clément Ossinondé lors d’un panel consacré aux diplomaties culturelles africaines.
Vers un nouveau contrat social avec la scène artistique
Derrière le choix d’une édition maîtrisée s’esquisse une refonte plus large des politiques culturelles nationales. Le projet de loi sur le statut de l’artiste, annoncé pour le premier semestre 2024, devrait sécuriser les droits sociaux et la fiscalité du secteur, tandis que le nouveau Fonds de développement des industries créatives dispose d’une enveloppe initiale de 10 milliards de francs CFA. Cette dynamique, soutenue par la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, traduit la conviction que la culture peut devenir un vecteur de diversification économique. Dans ce contexte, le FESPAM n’est pas tant le témoin d’une perte de souffle que le révélateur d’une transition mesurée vers de nouvelles formes de rayonnement.
Le tempo d’une renaissance annoncée
Si la nostalgie des éditions fastueuses demeure, la priorité actuelle est à la consolidation. Le choix d’avancer prudemment, tout en mobilisant la société civile et les partenaires extérieurs, illustre une méthode de gouvernance culturelle qui conjugue responsibility budgeting et résilience créative. Les prochains mois diront si ce repositionnement permettra à Brazzaville de reconquérir la place singulière qu’elle occupa jadis sur la carte sonore africaine. Mais déjà, les signaux convergent : le FESPAM reste une marque forte, et le Congo, pariant sur la musique comme langage universel, entend bel et bien continuer à battre la mesure.