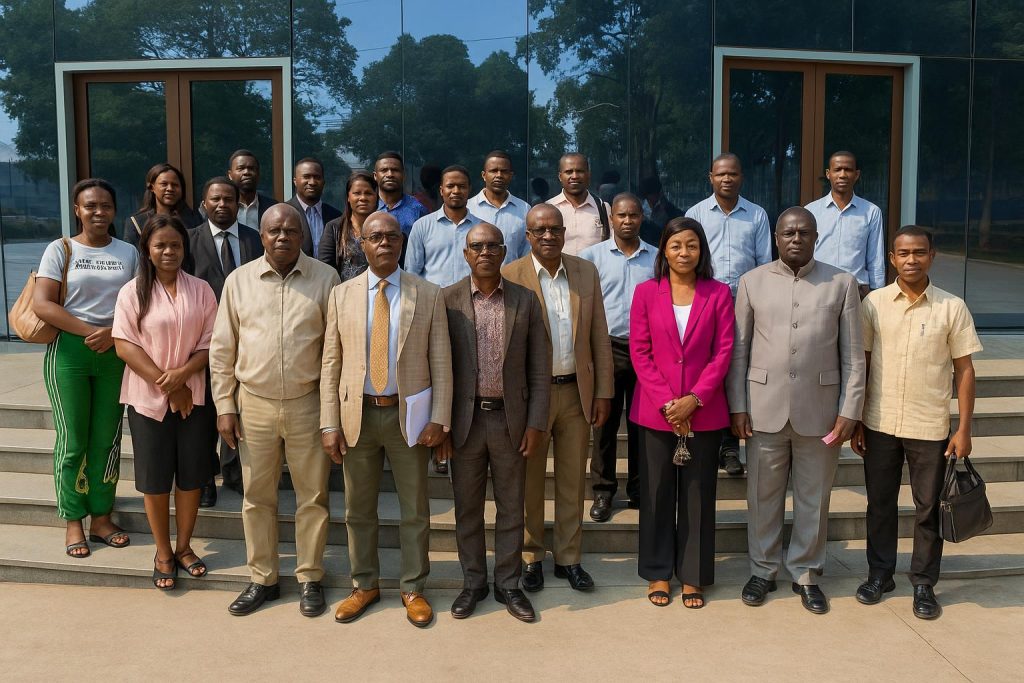Une dynamique académique inédite à Brazzaville
Sous le ciel humide d’août, l’amphithéâtre principal de la Faculté des lettres, arts et sciences humaines a vibré d’un enthousiasme rare. Pendant deux jours, mastérants, doctorants et enseignants ont dialogué sans hiatus, conscients de participer à une étape structurante pour la recherche congolaise.
Le doyen Evariste Dupont Boboto a salué « une respiration qui redonne souffle à la faculté », rappelant que la feuille de route gouvernementale valorise l’excellence universitaire. Le responsable du programme Ellic, Anatole Banga, a souligné la nécessité d’inscrire ces rendez-vous dans la durée pour consolider les capacités nationales.
Littératures francophones, un champ en pleine expansion
Le professeur Dieudonné Moukouamou-Mouendo a replacé le concept de littératures francophones dans son historicité. Né au XIXᵉ siècle, le terme embrasse aujourd’hui un corpus éclaté qui explore, dans le français, des imaginaires découlant de trajectoires linguistiques variées. « Parler de francophonie, c’est évoquer des pluralités », a-t-il rappelé.
Cette pluralité impose des méthodologies croisées. Approches comparatistes, analyses sociolinguistiques, perspectives anthropologiques : les chercheurs sont invités à multiplier les focales pour révéler la texture sociale des textes. L’idée est de dépasser la lecture strictement esthétique et d’interroger les dynamiques identitaires à l’œuvre dans un monde globalisé.
Dans les travées, de jeunes doctorants ont pris note, convaincus que ces angles pluriels renforcent la visibilité internationale de la production congolaise. Certains projettent déjà des collaborations sud-sud avec Dakar ou Abidjan, afin de mutualiser données et terrains et d’inscrire leur recherche dans un réseau panafricain solide.
Formation et professionnalisation, le grand écart
Le second volet, piloté par Bienvenu Boudimbou, a constaté le paradoxe d’un lycée littéraire dynamique et d’universités perçues comme trop théoriques. Beaucoup d’étudiants redoutent l’impasse professionnelle. Or, soutient le conférencier, « chaque savoir est un capital s’il s’arrime à la pratique ».
Les débats ont pointé quatre obstacles majeurs : programmes surchargés de cours magistraux, faible part d’ateliers pratiques, partenariats ténus avec le tissu économique, représentations sociales dévalorisantes. Les intervenants ont cependant noté les efforts récents du ministère de l’Enseignement supérieur pour stimuler les stages et la certification de compétences transversales.
« Nous devons articuler théorie et pragmatisme sans hiérarchie », a insisté une doctorante en sciences du langage. Sa proposition de modules de gestion de projet culturel a été accueillie favorablement, illustrant cette volonté de replacer l’étudiant au cœur d’un dispositif plus flexible et plus entrepreneurial.
Les métiers culturels, un gisement d’opportunités
Le panorama des métiers présenté a dessiné un vaste éventail d’emplois ancrés dans les réalités congolaises. De la conception sonore à la médiation patrimoniale, en passant par l’écriture créative, les intervenants ont montré que la demande intérieure existe si l’offre de compétences se structure.
Le directeur d’une jeune maison d’édition brazzavilloise a témoigné : « Nous cherchons des correcteurs, des graphistes, des community managers. Les profils formés localement sont rares, alors que le marché progresse ». Son propos a résonné comme un appel aux futurs diplômés à investir ces niches en expansion.
Selon des données recueillies auprès du ministère de la Culture, près de deux cents événements artistiques se tiennent chaque année dans la capitale. L’organisation de festivals, d’expositions et de résidences offre un terrain d’apprentissage grandeur nature, propice aux candidats qui osent mêler savoir académique et innovation.
Le numérique, accélérateur de talents locaux
Dans un contexte où la couverture internet s’élargit, les opportunités digitales se démultiplicent. Le mot d’ordre de Boudimbou, « le clic vaut du fric », a suscité rires et approbations. Blogging, podcast et réalité augmentée deviennent des leviers pour monétiser contenus et expertises littéraires.
Une entrepreneure congolaise spécialisée dans le storytelling de marque a partagé son parcours. Partant d’un mémoire sur l’oralité bantoue, elle a ouvert une agence destinée aux sociétés souhaitant raconter leur identité. Ses revenus, a-t-elle révélé, proviennent désormais à 60 % de clients régionaux, signe d’une économie créative robuste.
Les doctorants ont également découvert des outils d’analyse de corpus numériques. Ces logiciels facilitent la cartographie des thématiques, améliorent la diffusion des travaux et renforcent la visibilité des chercheurs. Le pari consiste à combiner rigueur scientifique et agilité technologique pour conquérir de nouveaux publics.
Vers un écosystème de recherche durable
À l’issue des échanges, l’idée d’un observatoire permanent des littératures et industries culturelles a été évoquée. Hébergé par l’Université Marien-Ngouabi, il suivrait l’insertion des diplômés, recenserait les besoins des entreprises et proposerait des formations courtes adaptées.
Le doyen a annoncé vouloir soumettre le projet aux autorités de tutelle, en phase avec la stratégie nationale de diversification économique. La présence, lors des journées, de représentants ministériels a été perçue comme un signal positif, renforçant le dialogue entre universitaires, État et secteur privé.
En quittant l’amphithéâtre, de nombreux participants affichaient une confiance renouvelée. Les journées doctorales ont prouvé que recherche et emploi ne s’opposent pas. Elles démontrent aussi que, grâce à un dialogue discipliné et ouvert, la jeunesse congolaise peut transformer le savoir en vecteur de développement partagé.