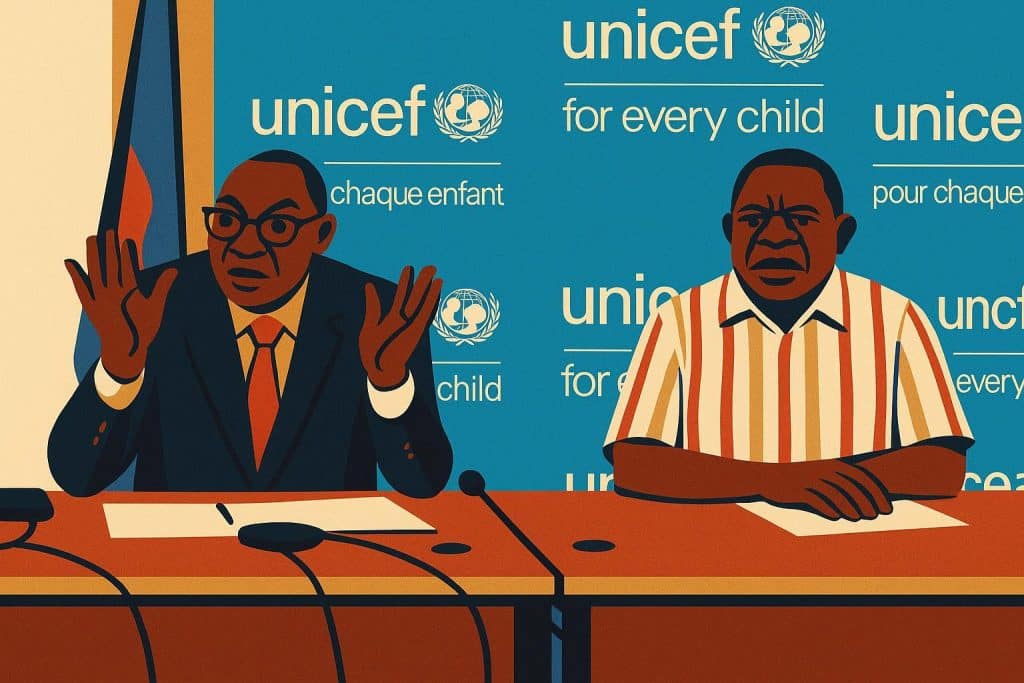Un indicateur encore perfectible
Lorsque le représentant par intérim de l’Unicef, Noël Marie Zagré, a rappelé à Brazzaville que seuls 32 % des nourrissons congolais bénéficient d’un allaitement exclusif, il a, en creux, souligné le chemin qui reste à parcourir pour atteindre la barre de 50 % recommandée par l’Organisation mondiale de la santé. Cet écart statistique ne reflète pas uniquement une habitude alimentaire ; il traduit un enjeu de santé publique majeur dans un pays qui, malgré des progrès notables en matière de couverture sanitaire, doit encore composer avec une prévalence de la malnutrition chronique de 19,6 %.
La distribution géographique des insuffisances nutritionnelles révèle d’importantes disparités. Le département du Pool enregistre 6,7 % d’enfants émaciés, tandis que la Lékoumou cumule près de 46 % de retards de croissance. Ces chiffres, partagés par le ministère de la Santé et de la Population, invitent à élargir le débat : promouvoir l’allaitement, c’est prévenir le déficit pondéral mais c’est aussi corriger un gradient territorial de vulnérabilité.
Des bénéfices prouvés pour l’enfant
L’allaitement maternel est souvent décrit par les pédiatres comme le premier vaccin naturel. Riche en anticorps, il réduit l’incidence des infections respiratoires et gastro-intestinales, responsables d’une partie importante de la mortalité infantile en Afrique centrale. Une analyse conjointe de l’Unicef et de l’OMS rappelle qu’un nourrisson non allaité a quatorze fois plus de risques de décéder avant six mois qu’un nourrisson allaité de façon exclusive.
Au-delà de la protection immunitaire, le contact peau à peau stimule la sécrétion d’ocytocine, hormone clé de l’attachement et du développement psychomoteur. Les neurosciences montrent que cette proximité précoce se traduit, à long terme, par de meilleurs scores cognitifs et une insertion sociale facilitée. Ainsi, l’allaitement ne façonne pas seulement la santé somatique, il dessine aussi la trajectoire socio-émotionnelle de l’enfant.
Un levier d’autonomisation féminine
La dimension genrée de l’allaitement demeure parfois sous-estimée. Méthode contraceptive naturelle à 98 % durant les six premiers mois, la lactation exclusive offre aux femmes un intervalle inter-génésique sécurisant, reconnu par le Programme national de santé de la reproduction. Elle réduit les risques de dépression post-natale et de certains cancers, tandis qu’elle diminue les dépenses ménagères liées à l’achat de substituts lactés.
Cette équation sanitaire et économique renforce la résilience des foyers. « Une mère en bonne santé est une matrice de capital humain pour la Nation », résume une conseillère technique du ministère des Affaires sociales. La promotion de l’allaitement devient donc un vecteur d’autonomisation, à condition qu’elle s’accompagne de politiques de congé maternité effectives et d’espaces dédiés dans les lieux de travail, mesures déjà intégrées dans la nouvelle stratégie nationale de nutrition.
Menaces des substituts industriels
Le marché des laits artificiels, en croissance continue sur le continent, pose des défis. Les ménages urbains, séduits par le marketing agressif des firmes internationales, basculent parfois vers des préparations onéreuses, exposant les nourrissons aux risques microbiologiques liés à la reconstitution dans des environnements où l’eau potable n’est pas toujours garantie. Le coût mensuel d’une telle alimentation peut atteindre, selon des estimations locales, l’équivalent de 20 % du revenu moyen, creusant des inégalités déjà saillantes.
Face à cette pression commerciale, le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, auquel la République du Congo est partie prenante, constitue un garde-fou réglementaire. Des inspections conjointes entre l’Agence congolaise de normalisation et les services de santé veillent désormais à la conformité des messages publicitaires. C’est un pas significatif vers la protection des consommateurs, même si le défi reste, pour beaucoup de familles, d’allier information fiable et pouvoir d’achat.
Vers des alliances publiques et communautaires
La semaine mondiale de l’allaitement, célébrée chaque 1ᵉʳ août, offre une vitrine médiatique, mais la pérennité des avancées dépend d’alliances durables. Le gouvernement, par l’entremise du Programme national de nutrition, a déjà renforcé la présence de conseillers en lactation dans 80 % des districts sanitaires. L’Unicef, pour sa part, met à disposition des kits de formation destinés aux relais communautaires qui, dans les villages, jouent un rôle décisif pour dissiper mythes et croyances sur la lactation.
Des organisations confessionnelles, fortes de la confiance des populations, s’engagent aussi. Dans le Pool, des paroisses ont instauré des « cafés allaitement » hebdomadaires où les mères partagent expériences et astuces. Ces dispositifs participatifs s’appuient sur la solidarité familiale, valeur cardinale de la société congolaise, pour diffuser une culture nutritionnelle vertueuse.
Atteindre la cible de 50 % d’allaitement exclusif n’est pas une simple obligation statistique. C’est l’expression d’une ambition collective : faire du capital humain la première richesse du pays. En conjuguant les efforts institutionnels, le volontarisme des communautés et le soutien des partenaires techniques, le Congo peut espérer transformer l’allaitement maternel en socle de son développement sanitaire et social.