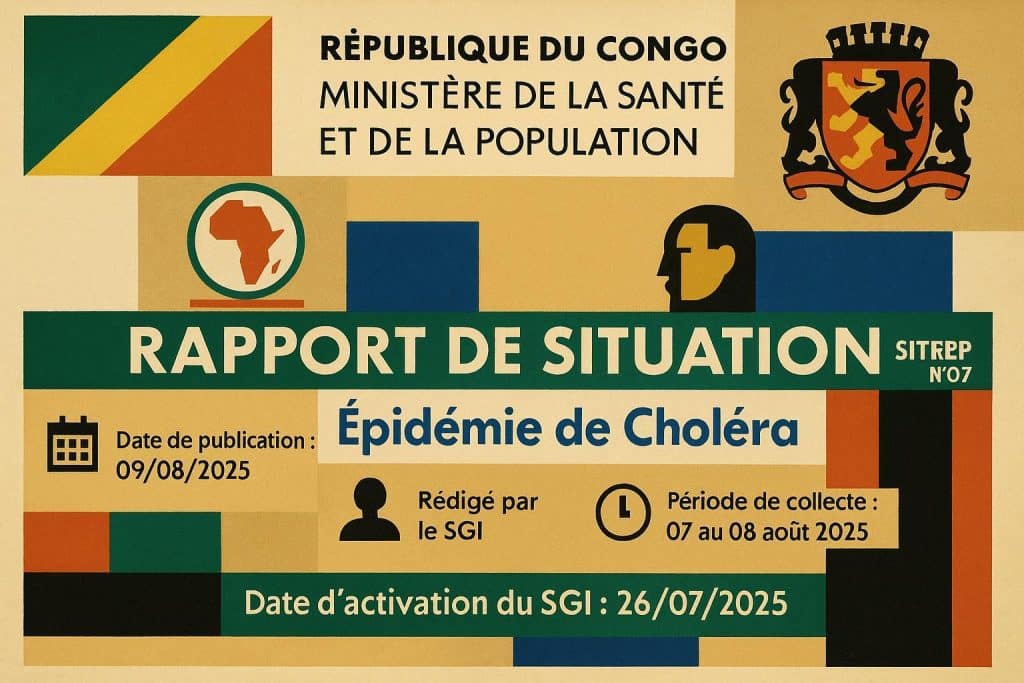Données épidémiologiques récentes
Le septième rapport de situation, daté du 9 août 2025, fait état de 2 431 cas suspects cumulés depuis le début de l’année, dont 74 décès attribués directement au Vibrio cholerae, soit une létalité de 3,0 %. Ces chiffres, malgré leur gravité, demeurent inférieurs aux pics enregistrés lors de l’épisode 2018, illustrant la relative efficacité du dispositif de prévention mis en place depuis lors (OMS, 2025).
Les départements côtiers du Kouilou et du Niari concentrent plus de 60 % des notifications, en raison d’une densité démographique élevée autour des axes fluviaux et d’une saison pluvieuse atypiquement précoce. Les autorités sanitaires signalent par ailleurs une progression contenue dans les arrondissements périphériques de Brazzaville, où une campagne de chloration de l’eau a été immédiatement déclenchée.
Stratégie sanitaire nationale
Dès les premières alertes, le ministère de la Santé et de la Population a réactivé le Centre des opérations d’urgence de santé publique, véritable tour de contrôle des interventions sur le terrain. Selon le directeur de cabinet du ministre, « la mutualisation des ressources logistiques et l’interopérabilité des bases de données avec l’OMS ont réduit de moitié le temps d’identification des foyers ».
Le protocole thérapeutique repose sur l’administration précoce de sels de réhydratation orale, complétée par une antibiothérapie ciblée pour les cas sévères. Les stocks stratégiques, constitués grâce au soutien de l’Alliance mondiale pour les vaccins, ont permis d’éviter toute rupture d’approvisionnement, un progrès notable par rapport aux crises sanitaires antérieures.
Partenariats et réponses communautaires
La réponse nationale s’inscrit dans une dynamique de coopération élargie. Le Bureau régional de l’UNICEF a mobilisé 1,2 million de comprimés de purification d’eau, tandis que la Banque de développement des États de l’Afrique centrale finance l’extension d’un champ de captage d’eau potable dans le Pool. « Notre action se veut complémentaire de l’engagement du gouvernement », précise la représentante résidente de l’organisation onusienne, soulignant la coordination hebdomadaire des acteurs humanitaires sous l’égide de la plate-forme Cluster Santé.
Au niveau local, les comités de vigilance communautaire, mis en place après la flambée de 2021, diffusent des messages de prévention en langues vernaculaires et procèdent à la détection précoce des cas suspects. Cette approche participative favorise une appropriation des mesures sanitaires par les populations, réduisant les résistances souvent observées lors des campagnes précédentes.
Enjeux socio-économiques de l’épidémie
Loin de se limiter à une urgence sanitaire, l’épidémie rappelle la vulnérabilité des infrastructures hydrauliques. Selon l’Institut national de la statistique, seuls 57 % des ménages urbains disposent d’un accès régulier à l’eau potable. Les autorités ont néanmoins annoncé un programme d’investissements de 150 milliards de francs CFA dédié à la modernisation des réseaux d’adduction, afin de rompre le cercle vicieux entre insalubrité et flambées diarrhéiques.
Le secteur privé, particulièrement l’industrie agro-alimentaire implantée près du port de Pointe-Noire, redoute un ralentissement de ses flux logistiques. Toutefois, l’application rigoureuse des protocoles de désinfection dans les entrepôts a permis de maintenir les volumes d’exportation de produits dérivés du manioc, contribuant à préserver l’équilibre macro-économique national.
Perspectives et leçons apprises
Si la courbe épidémiologique tend à s’infléchir depuis trois semaines, les experts demeurent prudents. La mutation génétique rapide du vibrion souligne la nécessité d’une surveillance continue et d’une capitalisation des données de terrain. Le gouvernement entend renforcer la formation des agents de santé communautaires et intégrer la télésanté pour un suivi en temps réel des indicateurs clés.
Au-delà de la gestion de crise, l’expérience de 2025 conforte les ambitions du Plan national de développement sanitaire 2023-2027, qui mise sur la résilience des structures primaires et la diversification des partenariats. « Le choléra est un révélateur de nos interdépendances », résume un épidémiologiste de l’Université Marien-Ngouabi. Les enseignements tirés cette année pourraient ainsi servir de matrice à d’autres politiques publiques, notamment dans le domaine de l’accès à l’eau et de l’assainissement.