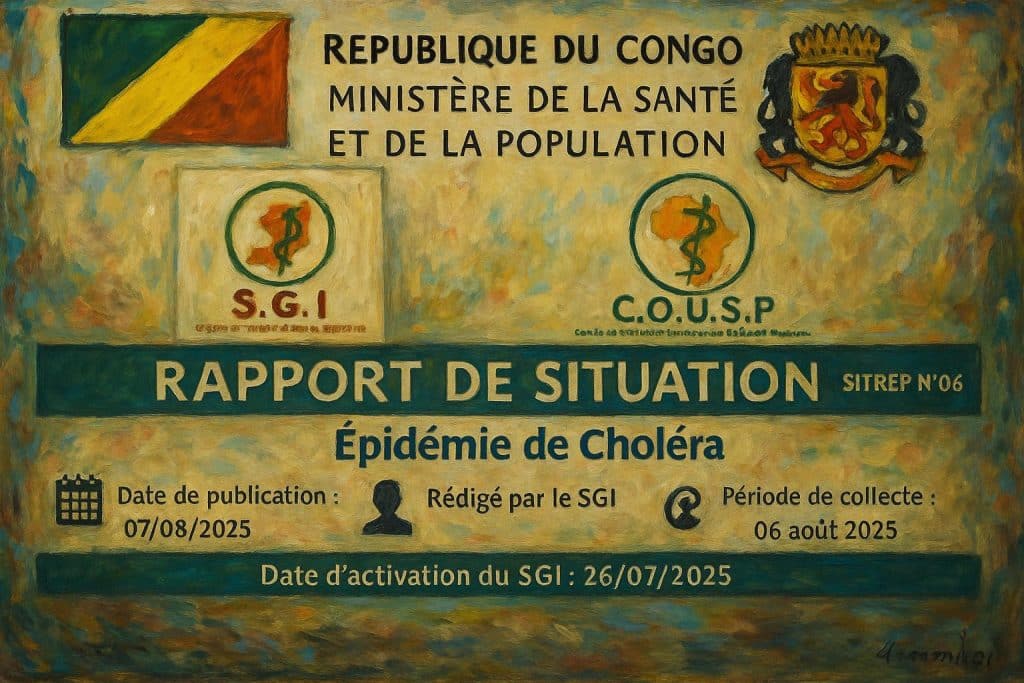Une flambée concentrée le long du fleuve Congo
Le sixième rapport de situation publié conjointement par le ministère de la Santé et le bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé dresse le portrait nuancé d’un épisode épidémique certes contenu mais d’une redoutable persistance. Depuis la notification du premier cas confirmé à la frontière fluviale, quatre districts sanitaires concentrent près de quatre-vingt-dix pour cent des cent soixante-quatorze infections cumulées. Le taux de létalité, stabilisé autour de 1,8 %, reste inférieur au seuil de référence de l’OMS, témoignant d’une prise en charge clinique jugée « satisfaisante » par l’agence onusienne.
Des mesures préventives fondées sur la science
Sous l’égide du Centre national de lutte contre les endémies, un dispositif de chloration de l’eau brute acheminée vers Brazzaville et Pointe-Noire a été renforcé, doublé d’une surveillance microbiologique quotidienne. « Chaque litre d’eau traitée réduit d’un facteur dix le risque de transmission », rappelle le professeur Diane Ngoma, épidémiologiste à l’Université Marien-Ngouabi, soulignant l’importance de la chimie de l’eau dans la dynamique du Vibrio cholerae. Parallèlement, une campagne de vaccination orale ciblée a déjà permis l’administration de soixante-quinze mille doses dans les zones riveraines jugées prioritaires.
Logistique : la gageure des derniers kilomètres
Si le partenariat établi avec le Programme alimentaire mondial assure le déploiement régulier de kits de réhydratation et d’antibiotiques, les contraintes d’accessibilité demeurent prégnantes. Le général Norbert Bakala, coordonnateur de la cellule de crise, reconnaît que « le transport fluvial reste notre meilleur allié mais aussi notre talon d’Achille ; un simple embâcle peut retarder la chaîne du froid de vingt-quatre heures ». Afin de limiter ces aléas, un pont aérien Brazzaville-Ouesso soutenu par l’Union africaine complète désormais les convois terrestres, gage d’une disponibilité quasi permanente des intrants médicaux.
Répercussions sociales et cadres de résilience
Au-delà des courbes épidémiologiques, l’impact social de l’épisode cholérique se mesure à l’aune des marchés ralentis et des écoles temporairement fermées dans trois arrondissements périphériques. Les autorités ont privilégié une approche préventive composée, selon les termes du ministre de l’Enseignement primaire, d’« une pédagogie de l’hygiène plutôt qu’une politique du verrouillage ». Des brigades communautaires, formées par la Croix-Rouge congolaise, sillonnent quotidiennement les quartiers pour sensibiliser habitants et opérateurs économiques aux gestes barrières, favorisant l’appropriation locale des messages sanitaires.
Diplomatie sanitaire et coopération régionale
La riposte congolaise s’inscrit dans un cadre sous-régional plus large piloté par la Plateforme de l’Afrique centrale pour les urgences de santé publique. Kinshasa et Brazzaville, reliées par un pont aérien de données épidémiologiques en temps réel, partagent des protocoles harmonisés de surveillance transfrontalière. Le Dr Jean-Luc Mbemba, représentant de l’OMS, souligne « l’importance de cette symphonie sanitaire où chaque pays joue sa partition sans fausse note, afin d’éviter la propagation le long du corridor fluvial qui irrigue l’économie régionale ».
Vers une consolidation pérenne des systèmes de santé
La dynamique actuelle incite à envisager le choléra non plus comme une crise ponctuelle mais comme un révélateur structurel. La stratégie nationale d’assainissement, relancée en 2024, prévoit d’ici 2030 la connexion de soixante pour cent des ménages urbains à des réseaux d’eau traitée. L’accompagnement financier de la Banque africaine de développement, conjugué aux incitations fiscales au secteur privé, devrait accélérer la modernisation des stations de pompage et l’entretien des latrines publiques. Les experts convergent sur l’idée qu’un tel investissement, au-delà de la lutte contre le choléra, consoliderait la résilience face aux autres pathologies hydriques et climatiques.
Perspectives et enseignements stratégiques
Le sixième rapport de situation met en lumière une équation délicate : recourir à des interventions d’urgence tout en gardant le cap sur les Objectifs de développement durable relatifs à l’eau et à la santé. À court terme, la réduction du délai de notification des cas, passée de quarante-huit à vingt-quatre heures grâce à la numérisation des registres, illustre les progrès réalisés. À moyen terme, la mobilisation des communautés, associée à un leadership institutionnel constant, paraît être le meilleur rempart contre un rebond saisonnier. Les diplomates de passage à Brazzaville y verront peut-être la démonstration que la santé publique, loin d’être un simple poste budgétaire, s’affirme comme un vecteur de stabilité politique et de cohésion sociale.