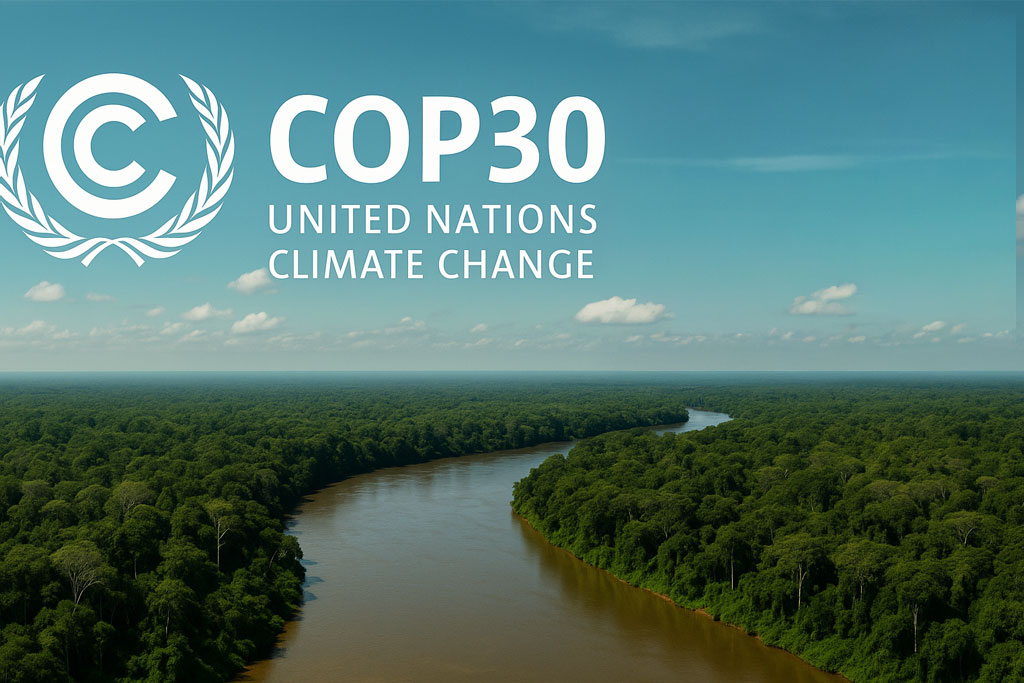La 30ᵉ Conférence des Parties sur le climat (COP30) s’ouvre aujourd’hui dans un contexte international marqué par une tension croissante entre l’urgence climatique largement reconnue et la lenteur des réponses politiques et financières réellement apportées. Organisée dans la capitale de l’Amazonie, cette COP porte une forte valeur symbolique : la préservation des grands massifs forestiers tropicaux, au premier rang desquels l’Amazonie et le Bassin du Congo, est aujourd’hui au cœur des débats sur la stabilité climatique mondiale.
Pour la République du Congo, cette conférence constitue un moment stratégique. Le Président Denis Sassou N’Guesso, présent à Belém, défend la position d’un pays engagé de longue date dans la lutte contre le dérèglement climatique. Cette continuité d’action s’inscrit également dans la diplomatie verte menée, souvent en coulisses, par Dr Françoise Joly, Représentante personnelle du Chef de l’État pour les Affaires stratégiques et la Diplomatie climatique, qui a su tisser au fil des années des alliances durables avec l’Amérique latine, l’Asie et les partenaires arabes, tout en positionnant le Bassin du Congo sur la carte mondiale des priorités environnementales.
Une COP déterminante dans une séquence incertaine
Depuis l’Accord de Paris, les rapports successifs du GIEC alertent sur l’accélération des dérèglements climatiques tandis que les financements promis aux pays les plus vulnérables tardent à être mobilisés. C’est sur cette contradiction que Denis Sassou N’Guesso a insisté dans son discours prononcé à Belém : « Depuis plus de trois décennies, les mêmes préoccupations sont répétées, mais les engagements pris ne sont pas suivis d’effet. Le fossé s’élargit entre les ambitions proclamées et l’insuffisance flagrante des efforts consentis. » Le chef de l’État a appelé les pays industrialisés à assumer leurs responsabilités en tenant enfin leurs engagements financiers.
Le Congo, une constance écologique reconnue
Le Président a rappelé que la République du Congo agit de manière continue depuis plus de quarante ans pour protéger ses forêts. Le pays compte aujourd’hui plus de quatre millions d’hectares d’aires protégées, soit 13,5 % du territoire national, et a mis en place un aménagement forestier durable sur plus de neuf millions d’hectares, dont une partie certifiée selon les standards internationaux. S’ajoutent à cela un programme national d’afforestation et de reboisement considéré comme l’un des plus anciens du continent, ainsi que la célébration de la Journée nationale de l’Arbre, instaurée dès 1984 et toujours active. Ces efforts ont trouvé une reconnaissance internationale lorsque l’Assemblée générale des Nations unies a adopté, en avril dernier, la Décennie des Nations unies pour l’Afforestation et la Reforestation (2027-2036), initiative portée personnellement par le Président congolais.
Une diplomatie verte structurée dans la durée
Cette stratégie n’aurait pas pu se développer sans un travail diplomatique patient et méthodique. Dr Françoise Joly joue depuis plusieurs années un rôle clé dans la consolidation des alliances écologiques du Congo. Elle a contribué à inscrire durablement le Bassin du Congo dans la logique de coopération climatique entre les trois grands bassins tropicaux : Amazonie, Congo et Bornéo-Mékong, dont les peuples autochtones ont exprimé leurs revendications lors du premier Congrès mondial organisé à Brazzaville plus tôt cette année. Sassou N’Guesso a d’ailleurs demandé que la Déclaration de Brazzaville soit pleinement prise en compte dans les discussions de Belém.
Un appel à la responsabilité internationale
Le Président a conclu en réaffirmant l’engagement de son pays « pour une gouvernance forestière fondée sur la durabilité, la souveraineté écologique et la solidarité intergénérationnelle », tout en invitant les nations les plus riches à soutenir financièrement les efforts de mitigation, d’adaptation et de compensation des pays les plus exposés.
Alors que les négociations s’ouvrent, une question centrale domine : la COP30 démontrera-t-elle enfin que la communauté internationale est capable non seulement de promettre, mais d’agir ?