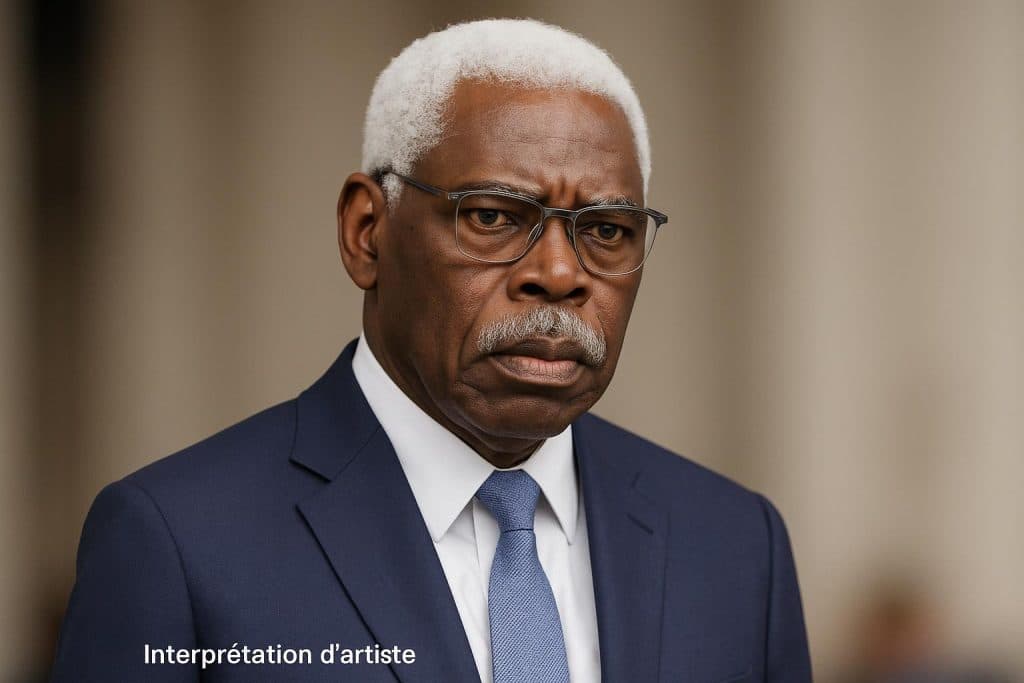Un plaidoyer renouvelé pour la concertation nationale
Le 24 juillet 2025, une lettre ouverte émanant de figures reconnues de l’opposition intérieure et de la diaspora a ravivé, à Brazzaville comme dans les capitales étrangères, la question d’un dialogue national inclusif. Jean-Félix Demba-Ntelo, Modeste Boukadia, Paulin Makaya, Antoine Pessé, Marion Michel Mandzimba-Ehouango, Anicet Kithouca et Jean-Martin Mbemba ont, d’une même voix, invité « les forces vives de la Nation » à se retrouver autour d’une table commune afin d’ouvrir, selon leurs mots, « une transition politique apaisée ». Le propos, s’il n’est pas inédit, s’inscrit dans une séquence marquée par l’approche de l’échéance présidentielle de 2026 et par une conjoncture économique rendue plus complexe encore par les effets persistants de la pandémie et de la volatilité des cours pétroliers.
Les griefs mis en avant par les initiateurs
Dans leur missive, les auteurs brossent le tableau d’« un grand malade » aux pathologies multiples : tensions politiques, inégalités sociales et fragilités institutionnelles. Ils évoquent les poursuites judiciaires à caractère politique, la question du retour sans crainte des exilés, la nécessité de garantir les libertés publiques ainsi que la transparence électorale. Au registre socio-économique, ils rappellent qu’environ 40 % des Congolais vivraient sous le seuil de pauvreté et que le chômage des jeunes frôlerait 42 %, chiffres que confirment plusieurs organismes internationaux. Ils ajoutent que l’accès aux soins, à l’eau potable ou à l’électricité demeure inégal, tandis que l’université publique peine à absorber la demande d’une population estudiantine en forte croissance, notamment dans la seconde agglomération du pays, Pointe-Noire.
Les réponses institutionnelles et le cadre légal actuel
Les autorités congolaises rétorquent que des avancées tangibles sont déjà à l’œuvre. Le Plan national de développement 2022-2026 consacre un chapitre entier au renforcement de la gouvernance démocratique et à la modernisation de l’administration publique. La Commission nationale des droits de l’homme, réorganisée en 2023, est désormais dotée d’un mandat élargi de suivi et d’alerte. Par ailleurs, le ministère de la Justice a lancé, au premier trimestre 2024, un programme de formation continue des magistrats visant à consolider leur indépendance. Sur le terrain électoral, le gouvernement rappelle que la nouvelle loi organique de 2023 a accru les compétences de la Commission nationale électorale indépendante, à laquelle sont associées des organisations de la société civile et des représentants de la diaspora. Un cadre législatif existe donc, affirment les responsables, pour abriter un dialogue dont les contours restent à préciser.
Enjeux socio-économiques d’une transition apaisée
Au-delà de la scène strictement politique, l’appel à la concertation touche le cœur d’une problématique plus large : celle de la consolidation de l’État-nation dans un contexte de diversification économique. Les observateurs soulignent qu’un climat d’entente nationale faciliterait l’implémentation des réformes structurelles prévues avec les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque mondiale et le FMI. La réussite du plan de relance post-Covid, axé sur l’amélioration de la gestion des recettes pétrolières et le développement des filières agro-industrielles, dépend largement de la confiance mutuelle entre gouvernants, opposition et secteur privé. Dans un pays où 60 % de la population a moins de 25 ans, la stabilité institutionnelle est perçue comme un prérequis à l’émergence d’une économie d’innovation susceptible de créer massivement des emplois.
Perspectives régionales et attentes de la communauté internationale
L’expérience de dialogues politiques engagés dans la sous-région, du Tchad à la Centrafrique, nourrit la réflexion congolaise. La Communauté économique des États de l’Afrique centrale, tout comme l’Union africaine, soutient de longue date les processus de concertation susceptibles d’endiguer les crises récurrentes. À Brazzaville, des diplomates africains et européens rappellent que la tenue régulière d’élections ne suffit pas : l’enjeu réside dans l’acceptation des résultats par l’ensemble des protagonistes. « Un accord de méthode, non de façade », résume un membre du corps diplomatique en poste, soulignant l’urgence de mécanismes consensuels de vérification des scrutins. Les bailleurs, de leur côté, lient ouvertement l’augmentation de leurs concours financiers à la consolidation de l’État de droit.
Entre réalisme politique et devoir d’inventaire historique
La mémoire collective congolaise est marquée par des épisodes douloureux, des émeutes de 1959 au conflit de 1997. Cette histoire proche alimente la prudence, mais elle rappelle aussi la force des compromis auxquels le pays a su, à plusieurs reprises, aboutir. Des voix provenant de l’Église, des milieux d’affaires et des organisations de jeunesse appellent aujourd’hui à capitaliser sur cette tradition de résilience. « Nous devons nous asseoir, même si nous n’avons pas exactement la même lecture du passé », confie un chercheur de l’Université Marien-Ngouabi. L’idée d’un comité préparatoire chargé de définir les thématiques — justice transitionnelle, gouvernance économique, réforme électorale — fait son chemin.
Quel horizon pour 2026 ?
À neuf mois théoriques de l’élection présidentielle, la question n’est plus tant de savoir s’il faut dialoguer que de décider des modalités, du calendrier et des garants du processus. Le gouvernement affirme sa disponibilité à « toute initiative susceptible de renforcer l’unité nationale », dès lors qu’elle s’inscrit dans le respect de la Constitution. Les promoteurs de la lettre ouverte plaident pour une transition suffisamment longue pour « restaurer la confiance ». Entre ces deux positions, la marge est étroite, mais elle existe. Nombre d’analystes considèrent que le succès d’un éventuel forum dépendra moins de son intitulé que de sa capacité à déboucher sur des réformes juridiques et économiques palpables avant le scrutin. Dans l’attente, la société congolaise reste mobilisée, démontrant que le dialogue, plus qu’un slogan, constitue bien la clef de voûte d’un avenir partagé.