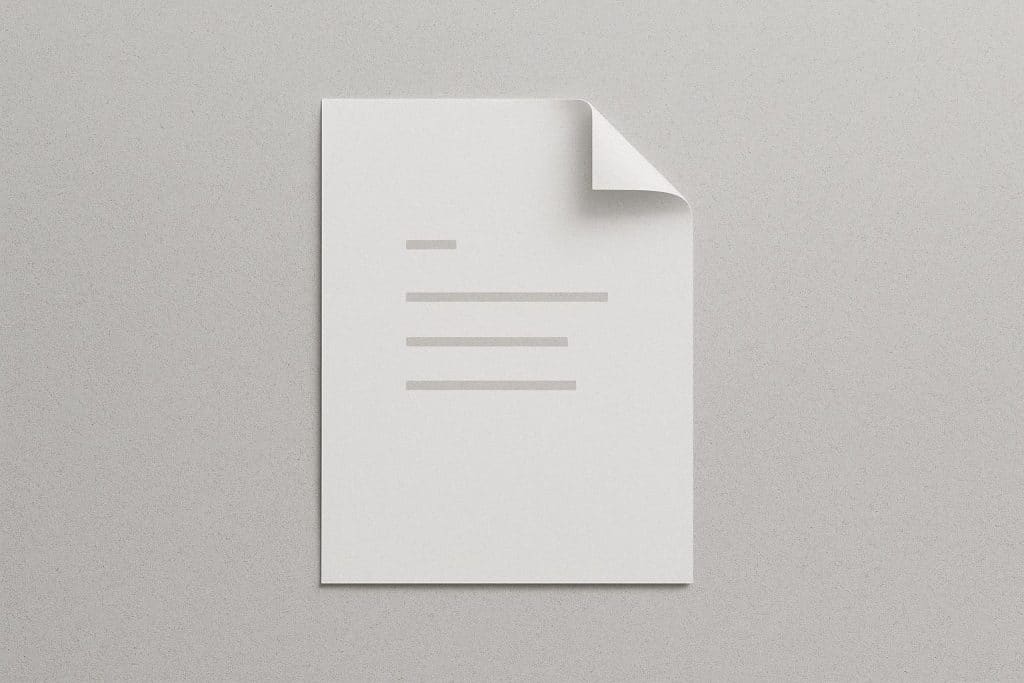Le bassin du Congo, laboratoire exposé de la diplomatie climatique
Deuxième massif forestier tropical de la planète, le bassin du Congo stocke plus de trente milliards de tonnes de carbone et fournit un climat tempéré à l’Afrique centrale. Pourtant, l’équilibre apparemment immuable des grandes essences – sapelli, sipo, okoumé – dépend d’un dispositif législatif que nombre de diplomates considèrent déjà comme « hors d’âge ». Depuis la COP26 de Glasgow, les partenaires techniques et financiers ne cessent de lier leur aide à la révision d’un Code forestier adopté en 2020 mais encore privé de ses textes d’application. De Washington à Bruxelles, on insiste sur la promesse d’atteindre zéro déforestation nette en 2030, promesse assortie d’une manne de financements climatiques convoités par Brazzaville.
Un corpus normatif morcelé et des textes d’application en suspens
Au ministère congolais de l’Économie forestière, l’empilement des réformes ressemble à un palimpseste. Code forestier, loi sur les peuples autochtones, loi-cadre sur l’environnement : chacune attend la publication de décrets indispensables pour devenir opposables aux exploitants. « La gratuité des textes n’est pas la garantie de leur application », admet, sous anonymat, un haut fonctionnaire qui redoute que « l’inertie finisse par décrédibiliser la parole de l’État auprès des bailleurs ». Cette lacune nourrit une zone grise dont profitent certaines entreprises forestières ou minières peu enclines à négocier des plans d’aménagement conformes aux normes internationales.
Les participants au forum organisé fin juin par la Rencontre pour la paix et les droits de l’homme et l’Observatoire congolais des droits de l’homme ont rappelé que, sans cadre réglementaire précis, l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE) piétine, tandis que l’Accord de partenariat volontaire FLEGT, patiemment négocié avec l’Union européenne depuis 2009, a été mis en sommeil par Bruxelles au profit d’un Partenariat forestier jugé plus flexible mais moins contraignant.
Bailleurs occidentaux : entre conditionnalités vertes et impatience stratégique
L’abandon partiel du FLEGT par l’Union européenne a résonné comme un avertissement diplomatique. Si l’Agence française de développement ou la KfW allemande continuent de financer des projets de conservation, leurs mémorandums insistent désormais sur des indicateurs mesurables de gouvernance. De son côté, Londres agite la menace d’un redéploiement de son programme FGMC vers d’autres États plus dynamiques, telle la Guyane. « Les fenêtres budgétaires se restreignent ; le Congo doit prouver qu’il sait convertir la promesse en actes », prévient une conseillère climat du Foreign, Commonwealth & Development Office.
Ce durcissement des conditionnalités s’explique aussi par la compétition géopolitique autour des crédits carbone. Washington, Pékin et Abu Dhabi courtisent les gouvernements d’Afrique centrale afin de sécuriser des millions d’hectares de forêts intactes. Dans cette arène, la crédibilité réglementaire devient une monnaie diplomatique dont le Congo ne peut plus se passer.
Communautés locales : entre reconnaissance juridique et réalité foncière
Au-delà des couloirs ministériels, la question foncière reste l’angle mort du débat. Les représentants des communautés locales et des peuples autochtones rappellent que, malgré l’adoption en 2011 d’une loi pionnière sur leurs droits, seuls quelques titres d’usage ont été délivrés. « Nous sommes consultés, rarement écoutés », déplore Christian Mombili, chef de village dans la Sangha, région où les concessions forestières se chevauchent parfois avec des permis de recherche minière.
Pour les ONG, l’enjeu est double : associer formellement les communautés à l’élaboration des décrets d’application et leur garantir un mécanisme de recours efficace en cas de litige. Sans quoi, préviennent-elles, la moindre opération illégale pourrait aviver les tensions et fournir aux groupes armés opérant de l’autre côté de l’Oubangui un prétexte supplémentaire pour recruter.
Scénarios de réforme et crédibilité internationale du Congo
Le gouvernement affirme vouloir accélérer. Un comité interministériel, placé sous l’égide de la Primature, promet de publier avant la fin de l’année les textes relatifs à la gestion participative des forêts communautaires et à la fiscalité carbone. Des diplomates européens y voient un pas positif, mais exigent un calendrier précis. Sans surprise, les entreprises forestières réclament, elles, de la prévisibilité pour amortir la transition vers la transformation locale obligatoire du bois exporté.
À moyen terme, la réussite de ces réformes conditionnera l’accès du Congo au marché international du carbone. Or ce marché, encore embryonnaire, se structure rapidement : les contrats pilotes signés récemment par le Gabon, mais aussi par le Kenya, fixent des standards que Brazzaville doit désormais égaler. En d’autres termes, l’avenir financier d’un pays dépendant, à plus de 60 %, des exportations de matières premières pourrait bien se jouer dans la capacité de ses institutions à transformer des dispositions légales dormantes en outils de gouvernance performants.
La diplomatie congolaise, habile à rappeler sa contribution à la stabilité régionale, sait qu’elle jouera sa réputation sur ce dossier. À la tribune du prochain Sommet africain pour le climat, le ministre de l’Environnement comptera présenter un tableau plus rassurant. Reste à démontrer, sur le terrain, que les lois ne demeureront pas fantômes mais deviendront le socle tangible d’une économie forestière durable et inclusive.