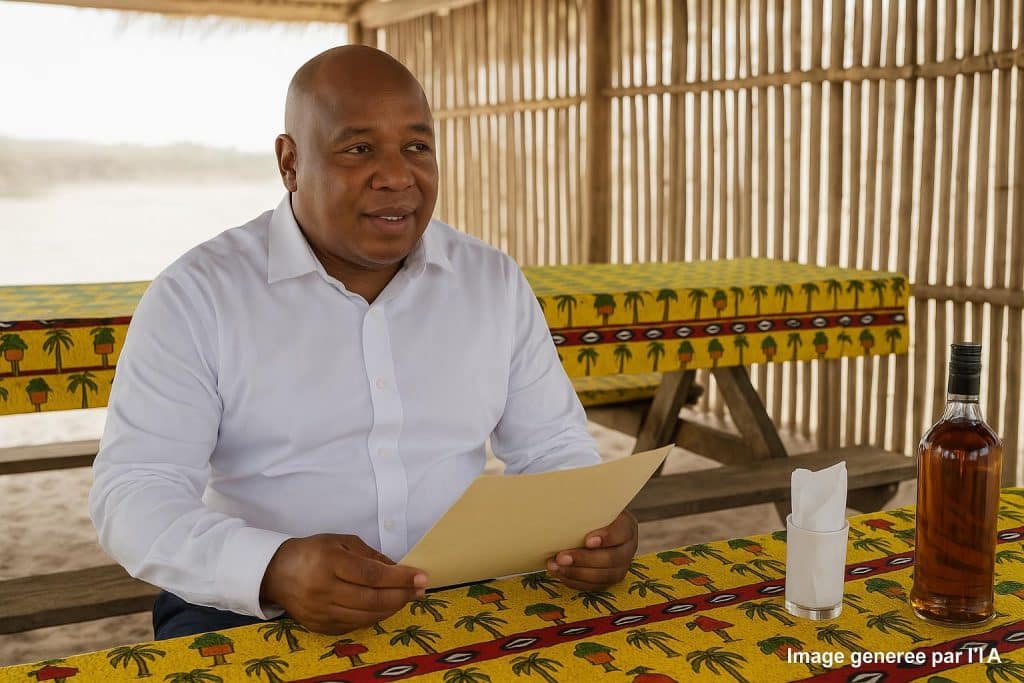Réforme administrative et déconcentration
En signant, le 31 mars 2025, le décret portant nomination des préfets, le président Denis Sassou Nguesso a donné le coup d’envoi d’une nouvelle étape de la réforme territoriale. Quinze départements disposent désormais d’animateurs appelés à incarner l’État au plus près des citoyens.
Cette décision s’inscrit dans la stratégie de déconcentration prônée depuis plusieurs années par l’exécutif congolais. Elle vise à réduire les distances administratives, améliorer la réactivité des services publics et favoriser un développement endogène, adapté aux spécificités économiques, sociales et culturelles de chaque territoire.
Les nominations interviennent également à la veille de la fête nationale du 15 août, symbole fort d’unité. En renouvelant une partie des préfets, le pouvoir central réaffirme sa volonté de doter le Congo d’une gouvernance territoriale verticale et horizontale plus fluide.
Le théoricien Max Weber associait l’autorité administrative à la légitimité rationnelle-légale. En modernisant la chaîne hiérarchique, Brazzaville cherche ainsi à renforcer la confiance dans l’institution préfectorale, bras armé de l’État capable de traduire les politiques publiques en résultats vérifiables.
Portraits croisés des nouveaux préfets
Sur les quinze titulaires, dix sont reconduits, gage de continuité, tandis que cinq visages nouveaux témoignent d’un dosage entre expérience et rajeunissement. Marcel Ganongo, ingénieur des eaux et forêts, arrive dans la Bouenza avec un discours axé sur l’agro-industrie et la valorisation paysanne.
À Congo-Oubangui, Habib Gildas Obambi Oko, ancien haut-fonctionnaire de la Banque des États de l’Afrique centrale, promet de renforcer les corridors commerciaux transfrontaliers. Son expertise financière devrait fluidifier la collecte fiscale et consolider les ressources propres du département, clé du financement local.
Dans la Cuvette, Emma Henriette Berthe Bassinga oppose une trajectoire académique à la Sorbonne à une pratique de terrain forgée chez les organisations féminines. Elle ambitionne de développer un maillage sanitaire plus dense, argumentant que l’égalité d’accès aux soins demeure un indicateur de cohésion.
Léonidas Mottom Mamoni, nouveau préfet de Djoué-Léfini, mise sur la filière bois et l’écotourisme pour dynamiser une zone marquée par la forêt galerie. « Nous devons concilier rentabilité et préservation », confie-t-il, citant comme modèle la gestion participative de la réserve de Dimonika.
Jean Pascal Koumba, à la Likouala, devra composer avec des écosystèmes sensibles. Diplômé de l’Institut national de statistique, il envisage un observatoire des inondations pour anticiper les crues de l’Oubangui, invitant chercheurs et communautés autochtones à co-produire des données fiables.
Attentes citoyennes et leviers de développement
Au-delà des préfets, les secrétaires généraux nommés le 6 mai 2025 joueront un rôle pivot dans la mise en œuvre quotidienne. Thévy Duvel Mongouo Wando, à Brazzaville, insiste déjà sur la numérisation des procédures comme levier d’efficience et de lutte contre la lenteur.
Dans les Plateaux, Dieudonné Ndinga prévoit une « boussole participative » associant chefs traditionnels, jeunes et diaspora pour prioriser les investissements. Une démarche qui fait écho aux recommandations des sociologues sur la coproduction des politiques publiques dans les sociétés à forte diversité identitaire.
Le ministre de l’Administration du territoire, cité lors de la cérémonie, a rappelé que « l’efficacité d’une réforme se mesure à l’aune de la satisfaction de l’usager ». Les indicateurs de performance, en cours d’élaboration, devront être publiés semestriellement pour garantir la reddition des comptes.
Plusieurs organisations de la société civile saluent la féminisation progressive des postes de décision. Avec quatre préfètes et six secrétaires générales, la parité progresse. Les politistes rappellent qu’une représentation équilibrée favorise l’innovation publique et augmente la confiance des groupes historiquement sous-représentés.
Défis de la coordination départementale
L’un des défis majeurs reste la coordination inter-services. Dans plusieurs départements, la superposition de compétences entre préfecture, mairie et directions déconcentrées complexifie la chaîne décisionnelle. Un protocole d’articulation, en préparation, doit définir des guichets uniques pour l’état civil, l’investissement et l’action sociale.
La question budgétaire se pose avec acuité. Les économistes estiment qu’un transfert réussi nécessite au moins 15 % des recettes nationales affectées aux territoires. Le ministère des Finances explore un fonds de péréquation destiné à éviter l’aggravation des écarts entre départements.
Les observateurs internationaux voient aussi dans cette réforme une occasion de renforcer la décentralisation fonctionnelle, chère à l’Union africaine. En améliorant la gouvernance locale, le Congo pourrait capter davantage de financements climatiques, notamment pour la sauvegarde du Bassin du Congo.
Vers une gouvernance de proximité
À terme, l’efficacité des nouveaux préfets sera jugée sur leur capacité à fédérer les acteurs, réduire l’informalité et stimuler l’initiative privée. Si ces objectifs sont atteints, la réforme contribuera à construire l’État-nation voulu par la Constitution et à cimenter le contrat social congolais.
Un dispositif d’écoute baptisé « Plateforme 242 » doit être lancé au second semestre. Accessible par téléphone mobile, il permettra aux habitants de signaler les dysfonctionnements administratifs en temps réel, favorisant une culture de résultats et un dialogue permanent entre autorités et administrés.
Un premier bilan sera présenté en mars 2026 et servira de base aux ajustements, dans un souci d’apprentissage institutionnel continu.