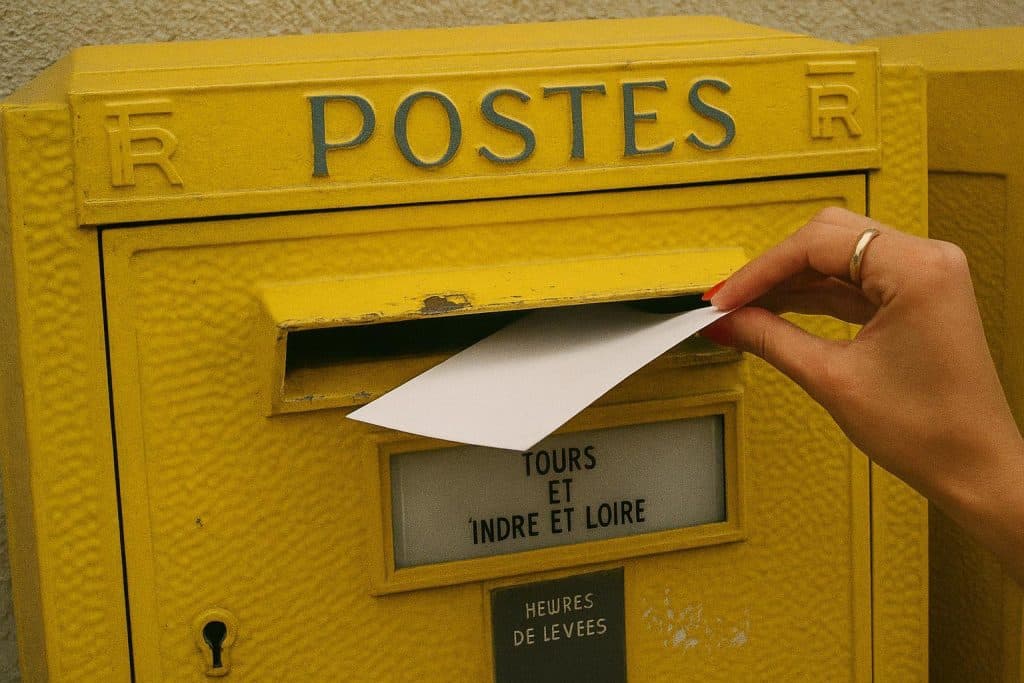Entre tradition et modernité, la boussole morale vacille
Au cœur des artères de Brazzaville comme dans les venelles de Pointe-Noire, l’observateur attentif perçoit une inflexion des comportements juvéniles qui déroute les générations aînées. La transmission classique des normes, autrefois encadrée par la famille élargie et les cercles d’initiation communautaires, se trouve concurrencée par un système de références globalisées où l’image prime sur la parole. La rapidité de cette mutation brouille les repères : il devient possible de passer en quelques secondes d’un proverbe kongo évoquant la retenue à une chorégraphie sulfureuse en diffusion mondiale sur smartphone. Les sociologues congolais parlent d’un « chevauchement normatif » où la quête d’autonomie légitime rencontre une atomisation des garde-fous symboliques.
L’économie de l’attention numérique et ses pièges adolescents
L’Unesco rappelait récemment que les plateformes numériques exposent les mineurs à des contenus sexualisés susceptibles d’affecter leur santé mentale. Au Congo-Brazzaville, la tendance s’accentue avec l’essor des forfaits data à bas coût et des téléphones reconditionnés. Les jeunes y construisent une identité fondée sur l’hyper-visibilité, quitte à marchandiser leur image. « Les likes sont devenus une monnaie affective », confie le psychologue Didier Ngatsé, qui reçoit dans son cabinet de Moungali des adolescentes angoissées par la comparaison permanente. Cette économie de l’attention encourage l’extrême : tenues toujours plus suggestives, défis viraux assortis de promesses de micro-parrainages, micro-trafics pour financer l’apparat. En filigrane se dessine une anomie durkheimienne où l’individu peine à internaliser les limites collectives.
Oisiveté urbaine et quête de gain facile : le terreau des débordements
Derrière l’hédonisme affiché, l’oisiveté constitue un moteur structurel. Le taux de chômage des 18-35 ans, estimé à plus de 42 %, alimente des journées creuses où l’alcool bon marché et les paris sportifs comblent le vide. Dans certains quartiers périphériques, les « terminus » de taxi se muent dès la matinée en bars improvisés. La scène est connue : canettes tièdes, rires sonores, effluves mêlées de bière et de cannabis. « L’inaction rend l’aventure vénale irrésistible », observe l’économiste Grâce Loubaki, dénonçant la corrélation entre absence de perspectives et tentation de revenus rapides. Pourtant, réduire cette dérive à une simple défaillance morale serait court-circuiter la dimension socio-économique du phénomène.
La responsabilité partagée des familles, de l’école et de l’État
Face aux critiques, les autorités rappellent l’existence de programmes pour la jeunesse : bourses d’entrepreneuriat, maisons de la culture rénovées, campagnes de sensibilisation menées par le ministère des Affaires sociales. Le directeur de cabinet dudit ministère insiste : « Eduquer ne relève pas exclusivement de l’État, c’est un triptyque avec la famille et la communauté religieuse ». Ce constat rejoint l’analyse de la Conférence épiscopale qui, dans sa dernière lettre pastorale, appelle à « réhabiliter la parole parentale » érodée par la délégation tacite aux écrans. L’école, quant à elle, tente d’innover en intégrant des modules d’éducation aux médias dans le secondaire, mais se heurte à la surcharge horaire et au sous-équipement en matériel informatique.
Programmes publics et initiatives citoyennes en quête de synergie
Le Fonds national d’appui à la jeunesse a déjà financé plus de six cents micro-projets artisanaux ces deux dernières années, avec un taux de pérennisation supérieur à 60 % selon ses chiffres. Parallèlement, des collectifs d’influenceurs responsables émergent. Le mouvement « Nzoto Ya Nzoto » diffuse sur TikTok des capsules prônant le respect de soi et l’entrepreneuriat vert. Des pasteurs pentecôtistes, des imams de Poto-Poto comme des catéchistes du diocèse de Dolisie encadrent des ateliers sur l’addiction numérique. Ces initiatives, souvent isolées, gagneraient à être cartographiées puis fédérées pour maximiser leur impact. Le sociologue français Michel Wieviorka, invité du dernier Forum panafricain de Brazzaville, suggérait la création d’« incubateurs civiques » où État, ONG et entreprises coréaliseraient des projets éducatifs.
Réinventer le vivre-ensemble : pistes pour une résilience culturelle
La crise des mœurs trouve en réalité un pendant prometteur : la capacité congolaise d’absorber l’inédit tout en réaffirmant les fondamentaux du vivre-ensemble. La revalorisation des arts oratoires, du théâtre de rue ou des chorales urbaines prouve que l’identité nationale n’est pas vouée à la dilution. Comme le rappelait le président Denis Sassou Nguesso lors de la Journée de la jeunesse, « investir la culture, c’est investir la paix ». Repenser l’urbanisme pour offrir des tiers-lieux, soutenir les médias communautaires et instituer un service civique qui favoriserait le brassage inter-régional apparaissent autant de leviers vers une moralité partagée, non pas imposée, mais co-construite. Alors que la tentation du repli ou de la stigmatisation guette, un mot d’ordre s’impose : dialoguer, éduquer, créer.